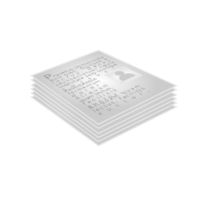
Diagnostic biologique
Les méthodes rapides de diagnostic reposent sur l'immunodiagnostic, à partir des cellules recueillies par écouvillonnage appuyé du plancher ou des berges d'une lésion ou encore par aspiration du liquide vésiculaire.
La recherche d'antigènes se fait par immunofluorescence ou technique immuno-enzymatique à l'aide d'anticorps monoclonaux spécifiques. Ces tests sont d'une exécution rapide, mais avec un risque de faux-positifs en présence de cellules desquamées.
La méthode de référence repose sur l'isolement viral sur culture cellulaire (cellules fibroblastiques ou épithéliales). L'observation de l'effet cytopathogène caractéristique (ECP) est possible après 24-48 heures de culture (cellules géantes multinucléées avec inclusions éosinophiles observables après coloration à l'éosine).
Le diagnostic peut être accéléré par détection des antigènes précoces produits lors de la multiplication virale en culture par immunomarquage à l'aide d'anticorps monoclonaux dès 24 heures. Enfin le typage de groupe (1 ou 2) peut être réalisé sur la culture à l'aide d'anticorps monoclonaux. Cette technique est la plus sensible en cas de recherche virale lors d'une excrétion asymptomatique orale ou génitale.
Autres techniques :
-
Dans le cas de l'encéphalite, la méthode de choix repose sur la PCR à partir du LCR. La PCR peut être également une aide à l'identification d'une excrétion virale chez le nouveau-né ou d'un herpès oculaire.
-
Le sérodiagnostic : il repose sur la détection et le titrage des anticorps. Ce sont des tests ELISA, identifiant les IgM et IgG. Il est surtout utile en épidémiologie et ne présente aucun intérêt pour l'urgence diagnostique.


